Actuellement en kiosque
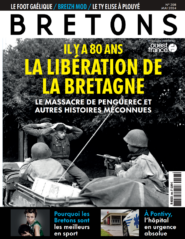
LES OUBLIÉS DE L’HISTOIRE
Les histoires méconnues de la libération de la Bretagne
C’était il y a quatre-vingts ans : en juin 1944 avec le Débarquement de Normandie, débutaient les opérations de libération de l’Europe. Si on en retient aujourd’hui des images de scènes de liesse dans les villes désertées par les Allemands, cet épisode renferme aussi des histoires moins connues et plus douloureuses…
Notre dernier hors-série
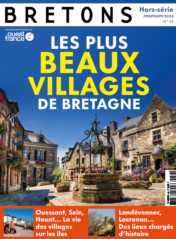
LA FÊTE AUX VILLAGES !
Connaissez-vous Bécherel, ce petit village qui est aujourd’hui une véritable cité du livre ? Et Pont-Aven, devenue le paradis des peintres après le passage de Gauguin ? Savez pourquoi Locronan possède un patrimoine aussi préservé ? Et quels évènements historiques ont bouleversé Saint-Marcel ? Quels sont les plus jolis ports des îles, ou les trésors cachés de l’Argoat?
Dans ce nouvel hors-série du magazine BRETONS, partez à la découverte des plus beaux villages de la région, du plus célèbre au plus méconnu !